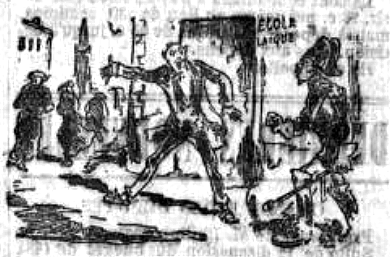1883
accueil année précédente année suivante
6 février 1883
M. Ch. de Lesseps
M. Ch. de Lesseps, directeur de la Compagnie du canal de Panama, a quitté Paris, hier soir, par la gare d'Orléans se rendant à Saint-Nazaire et de là dans l'isthme américain pour inspecter les grands travaux en cours d'exécution et le fonctionnement des puissantes machines récemment mises en mouvement.
M. de Lesseps est accompagné dans ce voyage par MM. Ernest Prévost, administrateur de la Compagnie Dingler, ingénieur en chef des ponts et chaussées, récemment chargé de la direction générale de la construction du canal, Dauzat, l'ingénieur du canal de Suez, et de nombreux ingénieurs et d'agents des différents services.
Le bateau de la Compagnie Transatlantique qui quitte ce matin Saint-Nazaire, emmène également une mission scientifique composée de M. Janssen, de l'Institut, et plusieurs astronomes en destination de Haïti, et M. Pascal Duprat, notre nouveau ministre au Chili, qui va prendre possession de son poste.
8 février 1883
Détournements par des employés des postes.
NOUVELLES judiciaires.
Un jeune employé des postes, Charles Barthe avait volé, le 22 septembre dernier, un pli contenant une somme de trois mille francs. Nanti des billets de banque, il alla retrouver son frère Armand, employé de commerce, et tous deux partirent pour Fontainebleau où ils passèrent quelques jours. De là, les deux frères visitèrent Clermont, Nevers, Toulouse et Lourdes où, se dissimulant sous de faux noms ils dépensèrent en débauches la plus grande partis de l'argent volé.
Quelques jours après, Armand Barthe revenait à Paris, où il tombait entre les mains de la police.
Sur ses indications, son frère fuit arrêté quelques jours plus tard à Bayonne. Charles Barthe n'avait plus en sa possession qu'une somme de quatre-vingts francs cinquante centimes. Dans l'espoir de se soustraire aux recherches, il avait falsifié une feuille de route qui lui avait été délivrée le 4 décembre 1880, par le commissaire de l'inscription maritime à Saint-Nazaire.
Les deux frères, qui ont fait des aveux complets, comparaissaient hier devant la Cour d'assises. Charles Barthe, qui était défendu par M° Bouchot, a bénéficié, grâce à son défenseur, des circonstances atténuantes il a été condamné à trois ans de prison. Me Maurice Binder, dans une habile plaidoirie, a enlevé l'acquittement d'Armand Barthe.
14 février 1883
EXPEDITION
Saint-Nazaire, 12 février. — Une expédition scientifique partira de Saint-Nazaire, par le paquebot du 6 mars, pour se rendre à ile-Caroline (Océanie).
Le commandant du croiseur l'Eclaireur a reçu l'ordre d'être à Panama, vers le 20 mars prochain, pour la recevoir.
3 mars 1883
EXPEDITION
L'expédition française qui a été désignée par le gouvernement, l'Académie des sciences et le Bureau des longitudes pour aller observer l'éclipsé totale de soleil du 6 mai prochain, quittera Paris le 4 mars ; elle s'embarquera le 6 à Saint-Nazaire, sur-un transatlantique à destination de l'isthme de Panama; elle traversera l'isthme en chemin de fer ; et, à Panama, le navire de guerre l'Eclaireur, prendra nos savants et les conduira, en vingt-cinq jours environ, à l'île Caroline, but de leur voyage. L'île Caroline dont il s'agit est située au nord de Tahiti et est absolument déserte; elle est entourée de bancs de coraux à travers lesquels il faudra trouver ou pratiquer une brèche pour aborder.
Après quelques jours de séjour, l'Eclaireur ramènera l'expédition à San-Francisco; ensuite nos savants se proposent de traverser l'Amérique en se livrant à des études météorologiques et astronomiques.
M. Tacchini, directeur du bureau météorologique de Rome, et un astronome de l'observatoire de Vienne, se joignent à notre expédition.
La mission américaine et la mission anglaise se rendent dans la même île Caroline qui, d'ordinaire déserte, possédera durant quelques jours, un vrai congrès de savants. On s'occupera de la recherche de petites planètes situées entre Mercure et le soleil, et on étudiera, par tous les procédés, principalement par la photographie, la constitution physique du soleil.
5 mai 1883
Le président de la République
Le président de la République a reçu une délégation des chambres de commerce de Nantes et Saint-Nazaire, ainsi que le maire de Nantes.
Cette délégation est venue entretenir le président des intérêts des ports de Nantes et Saint-Nazaire.
9 mai 1883
président du conseil des ministres.
Les délégués de Nantes et de Saint-Nazaire ont été reçus par le président de la Chambre des députés et par le président du conseil des ministres.
La veille, ils avaient été reçus par le ministre des postes et des télégraphes, à qui ils avaient fait vendredi une première visite.
Le préfet de la Loire-Inférieure s'était rendu à Paris en même temps que les délégués
14 mai 1883
CHAMBRE DEPUTE
M. Brisson préside.
On continue la discussion du projet de loi concernant les services postaux. M. Peulevey a répondu à M. Félix Faure et est attaché à démontrer qu'il n'était pas possible d'assurer les services maritimes postaux sans subvention.
Après M. Peulevey, M. Fidèle Simon a :parlé en faveur du port de Saint-Nazaire, puis la discussion générale a été close. M. Félix Faure a soutenu un contre-projet lui tend à rédiger un cahier des charges en vertu duquel le service maritime postal serait concédé à toutes les Compagnies qui rempliraient les conditions exigées.
M. Rouvier, rapporteur, et M. Cochery, ministre des postes et télégraphes, ont combattu ce contre-projet, qui a été repoussé par 13 voix contre 47. La Chambre a fixé la prochaine séance à mardi.
La séance a été levée à six heures, dix minutes.
7 juin 1883
PETIT GAMBETTA
Mercredi dernier, j'avais dit aux chiens de l'Exposition: « A revoir, mes demi-frères. Hélas! Je suis forcé de retourner à mes frères. » M. Waldeck Rousseau est un de ces frères Il est aussi un de mes pays.
Il est né en 1846. Son père et sa mère mariés depuis assez longtemps, n'espéraient plus d'enfants. Ils avaient adopté une petite fille. Un fils survient c'est l'aîné du ministre de l'intérieur. Un an après, arrive le ministre, dernier né. M. Waldeck-Rousseau père, représentant du peuple en 1848, ancien maire de Nantes, avait un remarquable talent de parole d'avocat. Très libéral, il se disait républicain à une époque où la forme républicaine pouvait encore concréter les idées de Liberté. M. Waldeck-Rousseau père était surtout religieux. Même avant les excès révolutionnaires des quatre dernières années, il était, à Nantes, de notre parti conservateur et il est mort très respecté, en odeur de réaction. Nécessairement, le jeune Waldeck avait été placé dans le pensionnat ecclésiastique de Nantes.
M. Waldeck-Rousseau père avait enseigné son fils à discourir, presqu'en même temps qu'à parler. Aussi le petit écolier s'écoutait-il déjà. Déjà il était calme, froid, fermé. Dévot et très fort en conférences religieuses, il semblait destiné aussi bien à la chaire ecclésiastique qu'à la barre ou à la tribune. Un incident décida de ses futures destinées. Le supérieur du pensionnat, l'abbé Pergeline, un prédicateur éminent, ayant estimé que le jeune Waldeck avait contrevenu à certain règlement important, dans sa Composition d'histoire de fin d'année lui fit donner 1a dernière place. Cette sorte de punition lui enlevait le premier rang en Excellence il n'était plus que le second. Le jeune Waldeck ne voulut point rentrer, le lendemain, au pensionnat. 'Voilà le point de départ de sa haine contre le clergé. D'autre part, cet incident scolastique, dont j'ai tous les détails, révèle déjà cet orgueil et cet entêtement à outrance de celui que, même ses collègues, appellent aujourd'hui « le petit Gambetta
Le jeune Waldeck-avait été exempté, en 1867, comme atteint d'une atrophie presque -complète de l'œil gauche. Borgne aussi-, lui; le petit Gambetta! Cette infirmité apparaît à peine. Cependant elle doit être cause, comme chez Gambetta, d'un manque d'équilibre dans les facultés ou le caractère.
Le jeune Waldeck se fit recevoir avocat. A Nantes, il ne pouvait être que le second de son père, décidé à rester à la barre jusqu'à la dernière heure. Il se fit inscrire à Saint-Nazaire préférant être te premier dans une petite ville, que le second à Rome.
A Saint-Nazaire, le jeune avocat vécut •seul, très seul. Il parla dans le prétoire presque désert du petit tribunal. Pendant les tempêtes, sa parole était accompagnée de la voix proche de la mer. Cependant, notre sublime Océan breton n'a pas même laissé dans l'oreille de l'orateur froid– le murmure mystérieux qu’il laisse dans les gros coquillages !
Dès que le jeune avocat se sentit un peu maître de son instrument, il chercha un champ plus vaste. Il s'établit à Rennes et non à Nantes. Cependant son frère aîné avait quitté le barreau nantais pour entrer dans l'industrie la meunerie, minoterie, etc. Mais le père parlait toujours.
A Rennes, il fut, comme à Saint-Nazaire, seul, très seul ! A peine allait-il au Café de la Comédie prendre un grog. Il avait déjà sa vieille cuisinière d'aujourd'hui. Son petit appartement était rempli de livres et aucun indice ne constatait une passion quelconque. si ce n'est beaucoup de pipes révélant un amour vif du tabac. Ce jeune homme n'a pas d'histoire comme doit être une femme honnête. Je le regrette pour le tribun. Le tribun doit avoir une vie privée tourmentée, comme la vie d'une grande actrice. C'est vrai de dire que M. Waldeck-Rousseau n'a d'un tribun que l'ambition.
Jusqu'au jour où la République fut définitivement constituée par la faute des conservateurs, M. Waldeck-Rousseau s'était prudemment réservé. Il ne s'était donné, pas même prêté, à aucun parti. Mais, quand on put se jeter facilement sur les débris de notre société conservatrice politique, le fils d'un conservateur fit comme les révolutionnaires. C'est l'éternelle histoire du chien qui portait le dîner de son maître!
Il s'était créé à Rennes un cabinet rapportant de 20 à 25,000 francs par an. La magistrature avait été favorable à la force et au succès de sa parole d'avocat. On peut dire qu'il a aiguisé son couteau sur le dos de la magistrature, bienveillante pour lui-avant de s'en servir pour lui percer le cœur.
Le voici député. Un jour, Gambetta, président, le vit monter au-dessous de lui, à la tribune. Il l'entendit… il l'écouta.
Ce n'était ni une grande voix, ni une grande parole, mais c'était un excellent instrument de tribune. Tout semblait servir ce jeune homme- même sa confiance excessive en lui et son ignorance provinciale de la grande lutte politique. Gambetta s'étonna de voir une sûreté pareille, un sang-froid semblable et une telle correction de langage. Aussitôt Gambetta aima cette parole qui était un contraste de la sienne. C'est la tendresse de la brune pour la blonde. Ah ce n'était point le superbe hurlement et le rehurlement du tribun Gambetta. C'était le vent réglé d'un soufflet d'orgue, qui seul animait les discours de M. Waldeck-Rousseau.
Ce n'était point cette longue phrase troublée, qui souvent avait le goût des plus célèbres crûs révolutionnaires, grandes années 1792 et 1793. C'était du vin décanté !
Mirabeau aimait fort le talent de Barnave, que Madame Roland trouvait si glacial. Toute proportion gardée, Gambetta rappelait Mirabeau, et M. Waldeck Barnave. Cependant notre jeune avocat est trop soucieux de sa propre fortune, pour donner, comme fit Barnave, toute son âme à une reine vaincue, admirablement belle. Il sera toujours fidèle à la République laide...tant qu'elle sera victorieuse !
Gambetta avait formé son grand ministère, à peu près comme un célèbre soliste compose une troupe de concert. Là, chaque ministre principal avait de la voix. Le choix de M. Waldeck-Rousseau ne pouvait surprendre. Il connaissait tous les airs les ayant appris en province. Cet apprenti devint tout à coup patron. L'enfant de chœur fut nommé évêque.
Gambetta savait bien qu'il ne serait jamais éclipsé par M. Waldeck-Rousseau. Certes, je ne veux point diminuer le cœur de l'homme privé, que j'ai vu de si près mais je puis dire que Gambetta. a toujours été un fidèle ami parce qu'il n'a jamais eu parmi ses amis, un homme dont la haute taille pût gêner la sienne !
Gambetta pardonnait au jeune ministre, même ses résistances. En effet, ce sous-ordre était resté le Breton orgueilleux et entêté, l'écolier qui ne veut pas être second Enfin, l'homme de granit qu'on est là-bas !
On se rappelle que les membres du grand ministère dînèrent à l'Elysée, le soir-même de la fameuse chute. Après dîner, Gambetta et ses anciens ministres, moins celui de l'intérieur, se réunirent dans un petit salon, pour causer de la journée et du lendemain.
M. Waldeck-Rousseau souligna son absence de cette réunion mortuaire, en se promenant, au grand salon, pendant près de deux heures. Il avait à son bras une femme, à qui il ne parlait pas. On me raconte que M. Allain-Targé, furieux, montrant à Gambetta l'isolé volontaire, dit bien haut « Là-bas ! Avec la dame… le « petit Robespierre ».
L'écolier si religieux, vice-président de la petite Société de Saint-Vincent de Paul du pensionnat, est devenu le ministre qui tout à l'heure va être un adversaire de la religion, plus cruel que M. Ferry lui-même. Déjà il s'allie avec le sinistre M. Bert et prononce comme menace le fameux mot anglais «no popery» « pas de papauté ».
Je sais qu'on retrouve là surtout l'orgueil jaloux.de l'écolier qui ne veut pas être second. M. Waldeck-Rousseau ne veut pas que M. Ferry soit le premier. Ce n'est point M. Waldeck-Rousseau qui fera rouvrir la chapelle de la rue des Gomiers, à Nantes. Pourtant elle est tout à côté de la maison de sa mère, la veuve si charitable et si pieuse. Là, sa mère allait prier trois fois par jour. Aujourd'hui, elle est forcée d'aller à l'église la plus voisine qui est bien lointaine pour les vieillards !
Cependant, M. Waldeck-Rousseau est encore de ces ministres révolutionnaires d'aujourd'hui qui, par peur des mœurs publiques, n'osent pas rester, comme leurs collègues, publiquement, à la porte de l'église, quand une cérémonie les appelle au dedans. Mais je me méfie davantage de ces ministres-là. Ils paient à la Révolution prêtrophage, par des persécutions plus cruelles leur entrée dans l'église !
M. Jules Ferry espérait vaguement que dans la tournée en Bretagne, M. Waldeck-Rousseau serait écharpé par ses compatriotes; un jour qu'il parlerait là-bas, comme il parle ici. Mais le malin a parlé en Breton !
II n'a point craché sur le crucifix, devant un peuple superbe, qui dessine encore la croix avec le couteau, sur le pain, avant de l'entamer.
Le pouvoir est la meilleure école, pour un homme politique. Déjà le discours de M. Waldeck-Rousseau s'est raccourci et empli. Sa phrase, comme une ouvrière qui veut travailler a relevé sa robe trop longue.
D'autre part, M. Waldeck-Rousseau a pour lui le prestige de la légende gambettiste. Même 1 a République française aujourd'hui journal d'outre-tombe, le soutient avec son influence toujours grande. Les partis politiques sont comme les canards– ils marchent encore, après avoir perdu leur tête 1
II va fait vite le long chemin qui va de Saint-Nazaire à la place Beauveau. Il n'est pas encore le premier au gouvernement– mais il n'est déjà plus le second. M. Jules Ferry n'a qu'à bien se tenir. Le ministre de l'intérieur ferait reconduire aujourd'hui, par les agents de M. Ma ce, même son ancien maître Gambetta si le fameux tribun avait l'idée de sortir tout à coup de sa tombe !
Et je reviens encore au physique de l'homme. Plus j'écris, plus je comprends que les biographies sont vaines et que seuls les portraits sont utiles. Les discours et les idées d'un homme changent son nez et sa bouche restent !
M. Waldeck-Rousseau est de taille moyenne et bien prise. Cependant le dos est très rond c'est le dos du père Waldeck, le vieux travailleur.
La tête est petite et ne saurait contenir cette chose énorme le génie. Debout, il tient souvent sa main à plat sur sa hanche. C'est là un trait breton. Nos nourrices ont cette attitude à peu près constante.
Les favoris sont rasés à la hauteur de l'oreille large. La moustache, d'un chatain foncé, est très fine. On la dirait postiche. De temps «n temps, les doigts, jaunis par la cigarette, semblent en cirer les bouts 1
Assis, il a le tic d'épousseter les genouillères de son pantalon peut-être souvenir des temps, où il s'agenouillait souvent !
Sa main passe parfois et lentement Ses cinq doigts, comme cinq dents de gros peigne blanc à cheval, dans sa chevelure brune, très correcte et partagée à l'occiput en deux parties égales. Cette chevelure rappelle étonnamment une perruque d'acteur, jeune premier. Les très gros yeux, très particuliers, ne sont point laids, malgré leur infirmité cachée, quand ils sont à demi fermés. Ils ressemblent, quand ils sont ouverts, aux trous d'un loup de bal masqué. Ses adversaires et même ses amis disent que le « petit Gambetta » a des yeux de grenouille, alors que le « grand Gambetta» » avait des yeux de taureau.
Mes comparaisons sont plus polies. Bref, le jeune ministre est un personnage grimé.
Si vous enlevez ce masque, vous trouvez une face d'assez beau jeune homme vieillot. C'est bien là le rejeton d'une République déjà trop vieille !
Et, lui-même, M. Waldeck-Rousseau, reproche la vieillesse à la République. Il a dit « Depuis le 4 Septembre, la République a perdu beaucoup de temps. Prenons garde d'arriver trop tard. » Il a peur non de la résistance des hommes, mais de la résistance des choses. Connaîtrait-il la loi fatidique qui nous gouverne les périodes de révolution remplacées par des périodes presque égales de contre-révolution? A Saint-Nazaire, il a vu, qu'à la grande marée du flux succède une grande marée de reflux. L'histoire subit les lois mathématiques de l'Océan.
Voici qu'après les orgies sanglantes du nihilisme l'apothéose de la royauté apparaît aux peuples sur le sommet de l'escalier rouge du Kremlin !
Toujours est-il que M. Waldeck-Rousseau, ce Benjamin de la Révolution, est très pessimiste dans l'intimité. Il fait fi des libertés.
Il représente déjà l'idée de la candidature officielle à outrance. Il veut inaugurer la TERREUR JACOBINE même ses fonctionnaires ont déjà peur de lui. C'est qu'il ne croit pas aux lendemains de la révolution actuelle. Or, une âme médiocre qui a goûté du pouvoir, est comme une petite bourgeoise qui a goûté de la débauche et en garde à jamais les dents agacées. Il veut et voudra être ministre, quand même. C'est là le trait principal que tous ses amis lui reconnaissent et qui doit compléter son portrait.
Or, il a déjà connu les conversions utiles, c'est-à-dire les chemins de Damas qui mènent au pouvoir.
M. Waldeck-Rousseau sera peut-être de ces ministres révolutionnaires- que les rois et les empereurs ramassent, hélas !- après la chute des révolutions Il sera peut-être quelqu'un ou plutôt, quelque chose, comme son compatriote Fouché, le jacobin devenu duc d'Otrante.
Oui, je vous reconnais, mon pays. En 1793, vous vous appeliez Fouché. Vous êtes non pas le « PETIT GAMBETTA » mais le « PETIT FOUChÉ, DE NANTES. »
Ignotus.
Félix-Louis-Joseph Platel est né en 1832 dans la propriété du Grand-Clavier en Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, sur les bords du lac.
baron Félix PLATEL dit IGNOTUS Journaliste au Figaro (1832-1888)
19 juillet 1883
SPORT NAUTIQUE
PRIX DE LA COUPE DU YACHT-CLUB DE FRANCE
Ainsi que nous l'avions annoncé, la première épreuve pour la Coupe du Yacht-Club de France a été courue à Saint-Nazaire, sous la direction de la Société du Sport nautique de l'Ouest.
En raison des conditions et du tonnage imposés par le Yacht-Club (les yachts doivent être français ou francisés et jauger au moins 15 tonneaux), trois concurrents seulement ont pris part à la course, qui a été, néanmoins, excessivement intéressante. Etaient engagés et ont couru :
Henriette, yawl de 83 tonneaux, à M. Pilon.
Eva, yawl de 40 tonneaux, à M. Fonade.
Stella, cotre de 15 tonneaux, à M. le docteur Jousset.
Le départ a eu lieu à huit heures du matin, par une bonne brise d'ouest, qui a malheureusement faibli vers midi; la lutte a été très vive entre les deux grands yachts Eva et Henriette, qui se sont constamment tenus pendant toute la seconde partie du parcours (15 milles), sans pouvoir arriver à gagner l'un sur l'autre la moindre avance. L'Eva portait, au vent arrière, une voilure invraisemblable, et l'Henriette avait également gréé toute sa toile. Aussi les deux champions ont-ils fini par passer le but d'arrivée dead-heat, chose qui se voit rarement dans une course à la voile.
Par suite de l'allégeance, Henriette rendant douze minutes environ à son concurrent, le prix a été gagné par l'Eva.
Un grand nombre de yachtsmen s'étaient rendus à Saint-Nazaire pour assister à cette course, dont l'institution témoigne, de la part du YachtClub de France, d'excellentes intentions que nous devons encourager ; c'est, en effet, par des courses de ce genre bien mieux qu'en distribuant des médailles et des baromètres, que cette Société encouragera le Yachting français, et nous ne désespérons pas de voir un jour le Prix de la Coupe couru et gagné par un yacht construit dans un chantier français — C'est là, selon nous, le but que doit se proposer le Yacht-Club de France.
Le préfet de la Loire-Inférieure et le souspréfet de Saint-Nazaire, ont suivi la course à bord du Saint-Joseph, gracieusement mis à la disposition de la Commission et de ses invités par M. le marquis de Préaulx.
*
Les yachts Etoupille, Amazone et Satanique battant le guidon du Cercle de la Voile de Paris, ont quitté Argenteuil se rendant à la mer. Le Para, à M Houssay, président du Cercle, descendra la Seine ces jours-ci à destination du Havre.
D'Artimon.
7 aout 1883
L'adjudication du service postal
L'adjudication du service postal des Antilles n'a pu encore avoir lieu, hier matin, au ministère des Postes.
Il y a eu seulement, un incident intéressant. „
La Compagnie Générale Transatlantique, qui était seule à se présenter, a déposé deux soumissions ; l'une de 6,520,000 fr. pour les services tels qu'ils sont réglés par le cahier des charges, avec-Saint-Nazaire comme port d'attache des lignes de Colon et de Vera-Cruz; l'autre, de 4,478,000 fr. pour les mêmes services, mais avec Je droit de faire du Havre le port d'armement des deux lignes dont Saint-Nazaire serait la tête, pour le service postal.
La première soumission, supérieure au maximum du ministre, a été repoussée ; la deuxième, qui pouvait être admise, mais qui soulevait une question à débattre, n'a pu être suivie d'une décision.
Un arrangement de gré à gré interviendra évidemment. M. Cochery est trop soucieux des intérêts du Trésor, pour payer 2 millions par an, soit 30 millions pour quinze ans, l'avantage à accorder à Saint-Nazaire d'être port d'attache au lieu de port d'escale.
L'ombre de l'ancien ministre de l'Empire Billault, inventeur de Saint-Nazaire, aurait des tressaillements d'aise, que la République ne lui procurera certainement pas. Entre nous, elle aura raison, car ils coûteraient trop cher
5 septembre 1883
COUP DE VENT
Me voici libre, après quinze jours de politique et d'affaires. Je voudrais enfin parler d'autre chose que d'affaires et de politique !
Chaque année, à ce jour-ci, je vais revoir ma grande amie, la Mer.
Depuis deux mois, le tout Paris est parti pour la mer ou pour la montagne. J'arrive trop tard pour dire qui, selon moi, vaut mieux de la Montagne ou de la Mer. J'ai aimé les Deux. Vivre, c'est aimer beaucoup de choses 1 Je ne suis point de ceux qui n'auront aimé, ici-bas, qu'-une femme, et qui deviennent de plus en plus rares, comme ceux qui ne lisent qu'un journal. Mais je suis revenu à mon premier amour, qui sera le dernier. Je n'aimerai plus que la Mer. Et cependant, que la Montagne est belle 1
En définitive, on aime l'une ou l'autre, selon l'heure qui sonne dans la vie. Toutes les deux, c'est le grand ciel, c'est la grande lumière. J'imagine que pour bien comprendre les Alpes, les Pyrénées, etc., il faut y aller, deux. Au contraire, pour bien voir la mer, il faut être seul.
D'autre part, si j'avais l'honneur d'être marié, et par conséquent d'être père de famille, je mènerais, pendant l'été, mes enfants sur les bords de la Mer. L'enfant a besoin d'être baigné dans l'immense piscine amère. C'est comme le baptême de son corps en voyant ces petits qui crient tant, quand, pour la première fois, on les bâigne dans l'Océan, je me rappelle les enfants qui, dans le baptistère d'une église, Vaillent, à la sensation froide de l'eau bénite I
***
Tous ceux qui aiment bien la Mer, l'aiment autant dans ses colères farouches, que dans sa tranquillité voluptueuse. La continuité du bleu énerve, et depuis quinze jours, les baigneurs las du beau temps azuré, rêvaient de noir. Voici qu'ils viennent d'être, sur nos côtes, servis à souhait.
J'ai fait ma première visite à la Mer, précisément à son premier jour de nerfs. Car elle a ses nerfs comme un être vivant. Elle est quelqu'un et vous feriez rire nos marins, si vous leur disiez qu'elle n'est que quelque chose.
Elle est quelqu'un. Cela est si vrai que la femme qui, la première fois l'aperçoit, se trouble comme devant un grand aimant inconnu et le chien né à Paris, qu'on amène ici, aboie en la voyant tout à coup !l
Donc, avant-hier matin, j'arrivai à Saint-Nazaire, à Nazaire, comme l'appellent quelques rouges de l'endroit.
Saint-Nazaire possède aujourd'hui un des plus grands bassins du monde. On y voit une vraie flotte, où les paquebots transatlantiques, ces villes flottantes, sont à peine les plus gros navires.
Imaginez la vue du bassin des Tuileries, avec ses petits vaisseaux, dix mille fois agrandis par une lentille énorme.
La loi sur la marine marchande, qui est une des cinq ou six bonnes lois que, par exception, notre Parlement ait votée, a rendu la vie à la marine qui mourait. En 1881, je n'avais vu ici que des navires désarmés ou que les gros steamers qui amènent à Saint-Nazaire, un des deux principaux colis d'exportation anglaise: le charbon. L'autre colis... est la Bible !
C'est marée haute. Le bassin est ouvert. Cardinal, le maître hâleur est à son poste. Son brigadier est ce matelot qui, jadis, a tant fait parler de lui.
Mousse naufragé, il avait été pris par les sauvages et il était demeuré sauvage pendant vingt ans. On voit ses oreilles énormément agrandies par la trace des colossales boucles d'oreilles et son nez reste troué par le grand anneau des Cannibales car on racontait jadis que Peltier a fait partie d'une tribu de cannibales.
Cela est plus logique que de manger les enfants, comme le proposait Swift.
Un peu en dehors de la rade, on aperçoit deux grands steamers qui ont arboré deux pavillons jaunes. Ce sont des navires venus de Bombay à destination du Havre. Ayant passé par le canal de Suez ils ont dû être mis en quarantaine. Or, le Havre ne possède rien qui puisse permettre à un gros navire de faire quarantaine. Ces navires ont donc été envoyés
J'ai eu le temps d'observer le va-et-vient de leurs embarcations qui, elles aussi, portent un pavillon jaune. On leur donne, de terre, les provisions avec les précautions réglementaires. Et cependant tout cela est illusoire. Si je l'avais voulu, j'eusse pu communiquer avec ces matelots, dont l'embarcation longe les bateaux à les toucher et qui s'arrêtent à causer avec les passants du bas des estacades. J'aurais donc pu recevoir la contagion et la communiquer... peut-être par cet article, à Paris.
Le lecteur comprendra que, sous cette forme, est un avertissement sérieux fait au ministère de la marine. J'ai promis ici de crier « gare » et j'exécute ma professe.
***
Cependant, le fils de l'armateur anglais de l'un de ces navires, que le hasard m'a fait rencontrer ici, se plaint amèrement de cette quarantaine, si mal observée, soit-elle.
Il est venu de Londres. Il me raconte que le chargement de grains à destination du Havre, va se détériorer, etc., etc.
Jamais je n'ai si bien compris John Bull ! Il ne s'occupe pas du tout de la santé des autres, et il s'occupe peu de la sienne. Les affaires, avant tout! Il n'admet pas les quarantaines. Cela explique pourquoi dans les ports de l'Orient, on appelle le choléra : « un voyageur anglais. »
Je dois dire que nos matelots français se garent fort peu de l'approche du 'pavillon jaune. Le marin français ne ferait pas cinq pas pour parer un danger?
J'ai retrouvé, toujours le même, mon peuple de matelots. Peuple heureux qui ne lit aucun journal ni les journaux de nos adversaires, ni les nôtres. Cependant, il a des idées arrêtées sur la vapeur. II ne l'aime pas. Un capitaine au cabotage me fait remarquer avec tristesse, que sur les steamers, on levait l'ancre avec un treuil tourné par la vapeur.
Il me dit : « La vapeur tue la marine. Bientôt, il n'y aura plus de matelots, comme déjà il n'y a plus de gabiers, parce qu'il n'y a presque plus de voiles. »
Cependant Saint-Nazaire a toujours ces magnifiques long-courriers, qui sont charmants quoique géants, étant la grâce énorme. Malheureusement la nouvelle loi sur la marine marchande a, comme toujours, oublié les petits. Les navires caboteurs de petit tonnage ne sont pas subventionnés... et c'est précisément la vapeur, cette goule qui dévore les matelots, que la loi nouvelle protège le plus!
***
Cet avenir un peu lugubre n'empêche pas le matelot de chanter. J'ai entendu un équipage ricorder, c'est-à-dire chanter le refrain. La chanson était le récit de la mort du matelot. Comme Mozart, le marin a composé son Requiem!
J'ai, une fois de plus, remarqué que le matelot qui marche au long d'une vergue ne regarde point autour ni au-dessous de lui. Ce serait dangereux de le distraire tout à coup de son œuvre qui l'absorbe. Il tomberait comme un somnambule qu'on réveille !
Deux gros bateaux à vapeur apparaissent. Par leurs deux pavillons juxtaposés, ils demandent l'entrée du, bassin. Ils mouillent en rade. Leurs énormes chaînes d'ancre, en se déroulant, produisent exactement le bruit lointain d'une mitrailleuse.
La vapeur sort par saccades des tuyaux et un rauque sifflement se fait entendre. On dirait d'un âne qui hennit et qui souffle par ses naseaux.
Un de ces navires est anglais le Thernbert, et l'autre est français, le Paul-Cazot, qui, heureusement pour lui, n'est point parent du Cazot trop connu.
Ici se produit un incident fort caractéristique. Quoique conduits par deux pilotes de Saint-Nazaire, les colosses subissent naturellement l'impulsion de leurs capitaines et c'est à qui d'eux entrera le premier dans le bassin. Alors les deux bateaux restent collés dans l'entrée, comme deux bouchons dans le goulot d'une bouteille !
L'incident manque de se changer en gros accident. Enfin, tout s'arrange et après un long travail, l'anglais arrive premier.
Cela m'a fait songer! Aujourd'hui l'alliance franco-anglaise est indispensable. Aujourd'hui les classes dites dirigeantes, ont oublié, chez les deux peuples, la haine séculaire mais les deux races s'en souviennent toujours I
Un pilote me fait remarquer que pendant cette longue manœuvre, le capitaine anglais,, qui parle très bien le français, n'a jamais voulu répondre au capitaine du port, quand celui-ci lui parlait en français. Toute l'histoire de l'Angleterre est là !
***
J'ai revu la vieille église qui est à coup sûr, la plus délabrée de France. On dirait de la coque d'un vieux navire. Pendant des siècles, ses fondations ont plongé dans la mer elle-même cela fait que peu à peu la maison est devenue bateau. Le clocher est comme un grand mât qui a sa hune. La cloche a des tintements de cloche de quart. Le bruit d'un vieil orgue se confond avec le bruit de la mer. Les fenêtres ressemblent à des sabords. Assurément la mer doit être le cimetière de cette église. Pendant les messes, on' doit ressentir le roulis et le tangage.
Comment se fait-il qu'un des principaux ports de France n'ait qu'une église et que cette église soit une sorte de vieux ponton? C'est que la madone de Saint-Nazaire ne jouit pas d'une bonne réputation parmi les matelots. D'autres madones de la côte ont tous les cierges et tous les vœux ! Comme c'est Breton !
***
A trois heures, le vent fraîchit. Les petits navires rentrent comme les poules dans le poulailler quand il va pleuvoir.
Une Marie-salope remorquée roule sur l'eau, pareille à une gigantesque tortue ! Imaginez que ces bateaux, remplis de la vase qu'on enlève du bassin, sont déchargés à quelques encablures du port, de façon que bientôt la vase retourne dans le bassin. Ces Marie-salope font donc un travail à la Pénélope. Tout le monde ici s'en plaint mais il paraît que ces salopes ressortissent à deux ministères différents. Un ministère ne veut pas que l'autre les commande... et les choses restent en l'état 1 Des petites trombes passent sur la mer, comme ces tourbillons de poussière qui, sur les roules de terre, précèdent l'orage. La mer, déjà en colère, crache sur la jetée, le baromètre baisse. On annonce un grain.
Des bateaux à vapeur de plaisance que je connais bien rentrent précipitamment. C'est la Vega, la Thérèse, enfin le Korrigan si coquet qui reste derrière les estacades.
Le plus charmant des navires minuscules de l'Etat un yawl apparaît dans la buée, déroulant sa longue flamme qui indique la marine militaire. Il fait, avec sa voile repliée comme un jupon une entrée superbe dans le bassin. J'ai envie de l'applaudir, comme l'entrée d'une danseuse de race...
Cela fait toujours plaisir de revoir nos malhurins de l'Etat. Sur le Mutin, garde pêche, on salue solennellement le pavillon, chaque matin et chaque soir cette cérémonie presque religieuse é sur un yawl, comme sur un cuirassé. La messe d'un capucin vaut réelle d'un évêque
Le vent souffle avec force à travers les nombreux mâts et cordages des navires. Les grelins vibrent comme des cordes de violons. Le concert va commencer.
Un autre jour, je phonografierai la mer. Je ne veux maintenant que raconter un coin de la tempête, comme on raconte un coin de la bataille". Malheureusement l'ensemble de la tempête ne peut s'apercevoir.
La rade est presque vide. Seuls apparaissent les deux grands steamers à pavillon jaune. Si leurs chaînes d'ancres allaient casser ! Le choléra faisant naufrage à Saint-Nazaire 1 Cela fait rire les matelots, mes voisins. Le choléra débarqué par force à l'extrémité du chemin de fer qui même à Paris !
Tout à coup un lieutenant du port étend la main vers l'horizon : « Eh ! là-bas, un sardinier qui est dehors. »
Chacun regarde. En effet, on dirait d'un pauvre papillon blanc qui voltige sur les flots. La mère est démontée. Je ne la décrirai pas. On sait que je me gare des clichés. Je ne veux voir, dans la tempête, que ce qui est un document.
J'ai dit: « Oh ! Pauvre bateau... mais il va périr ! Non, fait Cardinal, le maître hâleur, ça ne se noie pas plus qu'une sardine ! »
Cependant les matelots regardent de temps en temps le petit bateau. Je comprends qu'il est en danger quoique personne ne l'avoue.
Enfin le pauvre petit bateau qui, sur cette immensité, semblait une coque de noix avec une toile d'araignée pour voile s'échoue près du phare...
J'y cours. Du bateau sortent deux êtres, plus mouillés que des poissons, et à l'air bien las. L'un est un vieillard l'autre est un enfant. L'état ne veut plus du service de l'un et ne veut pas encore, du service de l'autre !
***
Le mousse a dix ans. Il est vêtu d'une large blouse cirée de matelot. Il est pareil à un groom qui serait habillé dans le pardessus du cocher.
Avez-vous remarqué que les mousses n'ont pas des yeux comme les autres ? Ils les ont ou trop petits ou trop grands. Celui-ci les a trop grands. Son corps disparaît dans la vareuse jaune et on ne voit que son regard. Le vieillard qui est son bisaïeul est presque aveugle. On dirait d'un Bélisaire conduit par un enfant.
Grande vision que la vue de ce couple si faible, venant de lutter victorieusement contre l'Infini !
Le coup de vent m'aura, du moins, apporté un tableau, bien petit mais immense comme un tableau de Meissonier.
Alors un de mes voisins me parle des mousses.
Il me dit que les chefs du parti conservateur pauvres chefs peu obéis 1 devraient se préoccuper de l'éducation religieuse des mousses. La révolution matérialiste veut biffer Dieu, sur mer, comme sur terre.
Ces mousses sont la graine de la patrie. Empêchons qu'on ne sème le chardon parmi eux.
On vient de me raconter une ancienne coutume bien touchante des mousses de Belle-Isle et du Croisic. Pendant la nuit de Noël, ils placent leur petit sabot, non pas dans le foyer de la cheminée et pour cause mais tout au haut du grand mât de la chaloupe.
Parfois, le petit Jésus y met une pièce blanche. Et je suppose, qu'en pareil cas, le patron du bord est le commissionnaire du Petit Jésus.
C'est avec ces charmantes légendes que les anciens mousses bretons vivaient et devenaient les premiers matelots du monde !
Au moment où j'écris, le coup de vent est dans toute sa force. Un de mes amis, pilote, me dit que le trois-mâts la Bretonne, vient d'échouer près d'ici sur le banc de la Bole. La mer hurle près de moi. Je puis dire, comme Jean, que j'écris en entendant la voix de l’abîme...
Mais j'ai revu la mer. Comme tant d'autres, je vais y prendre assez d'air et de lumière pour dix mois de buée parisienne. De même, on prend dans une semaine d'amour avec une femme -cette femme est rare assez de force et de courage pour le reste de l'année !
Ignotus.
10 décembre 1883
CES GENS LA. Scandale quotidien
La tribunal avait acquitté M. l'abbé Gaboriau, curé de l'église de immaculée-Conception, à Saint-Nazaire, qui avait arraché un drapeau placé impudemment sur son clocher à propos de la fête dite des assassins qu'on célèbre le 14 juillet.
Cette église a été bâtie sur un terrain à lui, avec une souscription de 300.000 fr. étrangère aux fonds de l'Etat. Donc le curé avait double droit à ce qu'on ne profane pas son église.
Mais le gouvernement, estimant que la nouvelle magistrature serait plus accommodante, a fait appel, et l'avocat général Bonnet, sur le siège du ministère, a eu le langage le plus inconvenant nous ne citons que ces mots rapportés par l'Union de Bretagne.
—Ces gens là, a-t-il dit en parlant du respectable curé de 1'immaculée Conception et des prêtres, en général, ne méritent que la prison
La cour a renvoyé son arrêt à huitaine.
Certainement, CES GENS-LA, qui parlent de la sorte dans un tribunal français, seraient plus à leur place dans en cabaret de bas étage qu'à la cour.
12 décembre 1883
HISTOIRE D'UN PRÉFET
Nous laissons à nos lecteurs le soin de décider si ce préfet de Nantes est un honnête homme ou s'il est une ignoble canaille
L'Espérance du Peuple confirme la nouvelle de l'expulsion des frères de Pontchâteau.
La lundi 3 décembre, en l'absence du maire et sans avis préalable, le sous-préfet de Saint-Nazaire, suivi de l'inspecteur primaire et d’une troisième personne arrivait à onze heures à Pontchâteau pour installer un instituteur laïc, nommé à ce poste par arrêté préfectoral du 25 novembre, en remplacement des frères.
Le premier et le second adjoint ayant refusé d'assister à l'installation, malgré l'invitation du sous-préfet, celui-ci trouva moyen d'entrer par fraude dans la classe des élèves en envoyant devant lui l'inspecteur qui, trouvant les élèves en récréation, témoigna le désir de les voir rentrer en classe, comme pour visiter leurs cahiers. Il fut fait selon son désir. Aussitôt on vit arriver le sous-préfet en personne, qui, sans précaution et à brûle-pourpoint, prévint le frère directeur qu'il venait installer le nouvel instituteur.
— Comment reprit le frère, je ne comprends pas; on ne m'a donné aucun avis.
Le sous-préfet lui annonça alors qu'on avait pourvu à son remplacement et, se tournant du côté des enfants, ce personnage leur dit en substance
— Mes enfants, vous aurez dès demain un nouvel instituteur. J'espère que vous répondrez à ses bons soins comme vous avez répondu à ceux de ses prédécesseurs.
Puis il invita le frère à lui remettre les clefs de l'école.
Le bon frère refusa d'abord, lui déclarant qu'ayant reçu les clefs du maire, il ne les rendrait qu'au maire; invité de nouveau avec injonction à obéir à l'ordre qui lui était donné, il les remit, croyant que devant la force il n'y avait pas à résister davantage.
Le frère se retira ensuite et les enfants quittèrent l'école.
Au voleur au voleur !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ils emportent la confiance,
Le lendemain, sur 150 enfants qui fréquentaient l'école, 26 seulement vinrent en classe.
Quel a été le motif du renvoi des bons frères?
Le frère directeur, pour se conformer à la dernière loi scolaire, avait fait la déclaration voulue.
Les délais expirés, n'ayant pas reçu da récépissé, il l'avait vainement réclamé. Cependant, on avait répondu à une dernière réclamation, qu'on le lui enverrait, qu'il pouvait se tenir tranquille.
Confiant dans cette réponse favorable, il avait ouvert l'école, sur la foi des traités.
Qu’a-t-on fait ?
Profitant de l'absence de cette pièce indûment retenue dans les bureaux, on l'a brutalement expulsé, et ce sera fort heureux si le préfet, se faisant de nouveau juge et partie, ne le révoque pas, avec la pensée, bien entendu, de l'empêcher de jamais exercer.
Voilà comment on rend la justice sous le régime des drôles qui détiennent la France dans leurs mains fétides